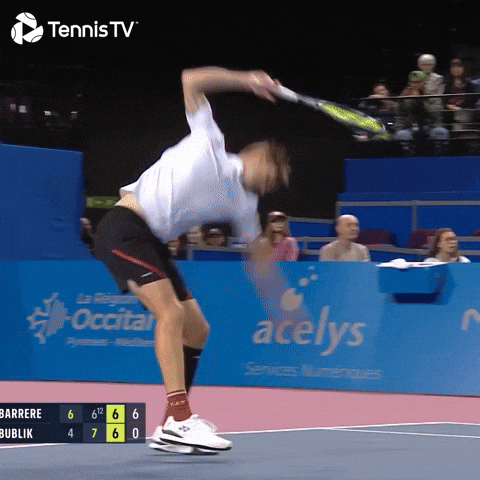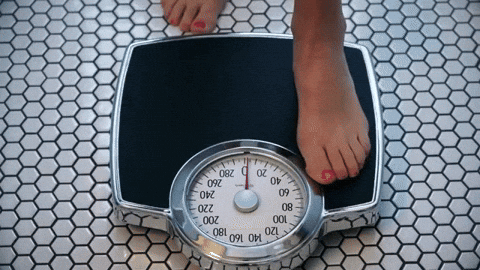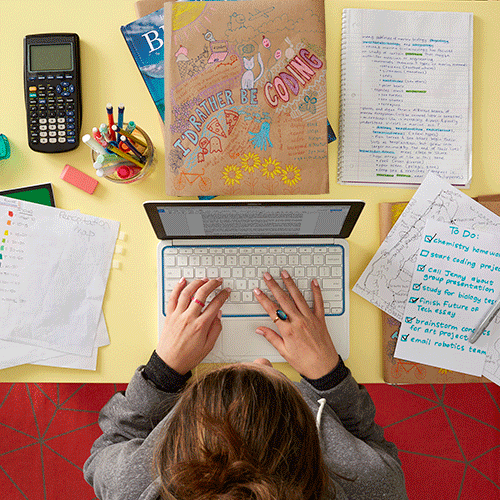Frustration, colère, impatience : comment accompagner son ado ?
Il rentre du lycée, jette son sac dans un coin et claque la porte de sa chambre. Vous n’avez encore rien dit, mais vous sentez déjà que la soirée sera tendue. 😤
À l’adolescence, la frustration peut surgir à tout moment : un devoir mal noté, un “non” à une sortie, une dispute avec un ami… Et parfois, tout semble disproportionné.
Colère, impatience, sentiment d’injustice… La frustration est souvent perçue comme un “mauvais caractère” ou un simple caprice. Pourtant, c’est une émotion naturelle qui joue un rôle clé dans le développement. La bonne nouvelle ? L’adolescence est justement le moment idéal pour apprendre à la reconnaître, à l’exprimer et à la transformer en moteur. 💪
Dans cet article, on vous explique pourquoi la frustration prend tant de place à cet âge, comment réagir sans envenimer la situation, et comment aider votre ado à en faire un levier pour grandir.
D’où vient exactement la frustration ?
La frustration, c’est ce mélange de déception, de colère et de sentiment d’empêchement lorsque quelque chose ou quelqu’un s’oppose à notre envie ou à notre besoin. Elle ne se manifeste pas de la même manière chez tout le monde, mais à l’adolescence, elle peut donner lieu à de vraies crises. ⚡
Définition de l’UNICEF :
« Lorsque les enfants qui ont déjà la capacité de mettre des mots sur leurs sentiments se sentent submergés, ils peuvent fondre en larmes, se mettre à hyperventiler ou piquer une énorme colère. À partir d’un certain âge, la crise est moins susceptible de se produire dans un lieu public car l’enfant se sentira gêné(e). En revanche, la crise peut tout à fait se produire à la maison. Par exemple, il arrive que les adolescents se contiennent pendant toute la journée à l’école et craquent en rentrant chez eux le soir. »
👉 Pour celui qui la subit comme pour celui qui la provoque, la frustration est souvent très difficile à vivre. Elle peut même devenir paralysante au quotidien si elle n’est pas bien gérée.
Pourquoi nos ados sont-ils particulièrement sujets à la frustration ?
D’un point de vue neuroscientifique, l’adolescence est une période de grands bouleversements. Le cortex préfrontal (zone du raisonnement, du recul) est encore en développement, alors que l’amygdale (zone des émotions) est en pleine effervescence. 🧠 Résultat : les émotions, dont la frustration, sont souvent décuplées et difficiles à canaliser.
Les ados ne savent pas toujours reconnaître ce qu’ils ressentent, ce qui peut donner l’impression d’être submergé ou impuissant, et provoquer des crises. À cela s’ajoute la quête d’autonomie : ils veulent être indépendants, mais dépendent encore beaucoup de vous… En bref, ils se sentent tiraillés en permanence. 🤯
Gérer la frustration : les bonnes pratiques pour ado
Comment communiquer avec un ado frustré ?
Comme d’habitude, on vous aide à trouver les bons mots pour apaiser votre ado !
Ce qu’il faut dire :
Accueillez l’émotion sans la juger. Montrez à votre ado que la frustration est normale, qu’il a le droit de la ressentir et que ce n’est pas grave. 🙂 Aidez-le à mettre des mots sur ce qu’il vit :
- « Je vois que tu es déçu(e), c’est normal de l’être quand on n'obtient pas ce qu’on veut. »
- « Tu as le droit d’être en colère, mais voyons ensemble ce qu’on peut faire. »
- « Qu’est-ce qui t’a le plus frustré dans cette situation ? »
Ce qu’il ne faut pas dire :
Évitez de culpabiliser (« Tu exagères ! »), de minimiser (« Ce n’est pas grave, passe à autre chose »), de se moquer ou de s’énerver en retour. Vouloir « réparer » la frustration trop vite en cherchant à tout prix à la faire disparaître peut être contre-productif, car cela nie l’émotion ressentie.
D’un point de vue neuroscientifique, cela empêche le cerveau de l’ado de s’habituer à gérer la frustration, un apprentissage pourtant essentiel pour devenir adulte.
💡Partagez aussi vos propres frustrations ! Racontez-lui un moment où, même adulte, vous avez dû gérer une déception ou une attente non satisfaite. Cela aide à dédramatiser et à montrer l’exemple.
Quel est le bon comportement en cas de frustration ? Quels sont les écueils ?
Une fois la vague émotionnelle passée, encouragez votre ado à exprimer ce qu’il ressent, à se raccrocher aux faits (« Qu’est-ce qui s’est vraiment passé ? »), à rationaliser et, si besoin, à évacuer physiquement la tension (sport, balade, musique…). 🫶
Le rôle du parent est essentiel :
« Un ado apprendra bien mieux à gérer sa frustration s’il voit un parent capable de dire : “Je suis déçu, mais je vais faire autrement” plutôt que d’exploser ou d’abandonner. » Anne-Claire de Pracomtal, psychologue et co-fondatrice d’IAMSTRONG
Les écueils que votre ado doit éviter :
- Ressasser la situation en boucle
- S’enliser dans la rumination
- Chercher des « complices » pour conforter son mécontentement
- Blâmer systématiquement les autres ou contourner la frustration
👉 Dans ces cas, invitez doucement au recul :
- « Qu’est-ce que tu pourrais faire autrement la prochaine fois ? »
- « À ton avis, sur quoi tu peux vraiment agir ? »
Gérer sa frustration au quotidien : à qui demander de l’aide ?
Si la frustration devient envahissante (colères fréquentes, réactions excessives, comportements à problème…), il est important de chercher un allié. Un parent, un adulte de confiance, ou un professionnel peut accompagner votre ado. 😉
Chez IAMSTRONG, nos coachs certifiés et psychologues aident les ados à trouver un équilibre grâce à une approche positive, inspirée des Thérapies Cognitivo-Comportementales (TCC) et du coaching.
Notre accompagnement repose sur trois piliers :
- Des séances individuelles en visio avec un professionnel choisi selon vos besoins
- Des activités en ligne pour approfondir entre les séances
- Un chat avec le professionnel pour un soutien en continu
N’hésitez pas à prendre rendez-vous gratuitement pour faire le point ! 🔥
Comment transformer sa frustration en motivation ?
Et si la frustration devenait un moteur ? Elle naît souvent d’un échec ou d’un empêchement, mais peut aussi ouvrir la voie à la persévérance et à la résilience. 💪
Exemples concrets :
- Mauvaise note : encouragez-le à analyser ce qui n’a pas marché (manque de méthode ? Révisions trop tardives ?) et à tester une nouvelle stratégie ensemble. Vous pouvez lui dire : « Qu’est-ce que tu peux faire différemment la prochaine fois ? »
- Conflit amical : discutez de ce que cette situation lui apprend sur la communication, les limites ou le choix de ses amitiés. Par exemple : « Qu’est-ce que cette situation t’apprend sur toi ? »
- Règle imposée à la maison : proposez-lui de réfléchir à des compromis ou à être force de proposition. Dites-lui : « Quelle tâche de la maison, qui aiderait tout le monde, pourrais-tu prendre en charge ? »
En l’accompagnant pas à pas dans cette réflexion, vous lui montrez que la frustration n’est pas une impasse, mais un signal : quelque chose doit changer, et il peut agir pour y parvenir. Ce regard transforme une émotion désagréable en énergie constructive… et c’est une compétence précieuse pour la vie adulte. 😉
La frustration est une émotion inévitable, mais pas insurmontable. En aidant votre ado à la reconnaître, à l’exprimer et à la transformer, vous lui offrez des clés pour devenir un adulte épanoui et résilient. Avec bienveillance, patience et dialogue, chaque frustration devient une occasion d’apprendre… et d’avancer.
On se donne rendez-vous sur le blog pour d’autres conseils dédiés aux parents d’ados ! 😉
Comment parler de consentement à son ado ?
Depuis l’affaire Weinstein et l’explosion du #Metoo en 2017, le consentement est devenu un sujet central dans les médias, la politique et le quotidien. Cette notion ne concerne pas seulement la sexualité, mais toutes nos relations : amicales, amoureuses, familiales.
Dans les faits, le consentement permet de repenser la façon dont on aborde non seulement la sexualité, mais plus largement les relations avec autrui. 👀 Et à l’adolescence, ça a toute son importance.
En tant que parent, vous vous demandez sûrement comment aborder le sujet avec votre ado : comment faire passer le bon message sans l’effrayer ? Comment lui apprendre à respecter le consentement des autres, mais aussi à faire respecter le sien ? 🤔
Voici un guide clair, pratique et inclusif pour en parler.
C’est quoi exactement le consentement ?
Le consentement, ce n’est pas un gros mot, et ce n’est pas un principe dont il faut se méfier ou dont il faut avoir peur. Bien souvent associée à la sexualité, cette notion régit en fait l’ensemble de nos relations sociales : romantiques, amicales et même familiales. 🙂
Nous avons demandé à Anne-Claire de Pracomtal, psychologue et co-fondatrice d’IAMSTRONG, sa définition du consentement :
« Le consentement, c’est le fait de dire “oui” librement, clairement, de manière éclairée, donc sans subir aucune pression. C’est aussi s’autoriser à dire non, de poser des limites ou à changer d’avis à tout moment. Par exemple, dans le cadre de la sexualité, ce n’est pas parce qu’on a dit oui une fois que ce « oui » est valable à tout moment. »
Votre adolescent ou adolescente a probablement déjà entendu parler de consentement sexuel sur les réseaux sociaux, à travers des messages plus ou moins clairs ou plus ou moins bien articulés. Voici des messages simples à lui faire passer concernant la sexualité :
- Personne ne doit se sentir forcé d’avoir une relation sexuelle, toi y compris.
- Un “non” même flou doit être entendu et respecté immédiatement.
- Seul un vrai “oui” clair et enthousiaste compte.
- On peut changer d’avis à tout moment.
Si pour vous, la définition du consentement n’est pas encore limpide et que vous ne savez pas quels termes employer auprès de votre ado, pas de panique. Commencez par cet article et continuez de documenter sur le sujet. On vous donne tout plein de ressources en conclusion ! 😉
Inculquer le consentement à son ado : pourquoi c’est essentiel ?
Entretenir des relations saines avec les autres
Apprendre à son adolescent à respecter le consentement d’autrui doit devenir une norme, un véritable réflexe dans toutes ses relations.
Respecter le consentement, c’est avant tout respecter l’intégrité de l’autre. Cela signifie ne jamais outrepasser les limites posées, même si elles paraissent incompréhensibles ou insignifiantes. Un geste, une parole ou un acte peut sembler anodin à votre ado, mais être vécu comme une intrusion ou un traumatisme pour un autre. 🧐 Par exemple : un câlin, une question intime…
C’est pourquoi le consentement est une notion fondamentale pour s’épanouir et bien s’insérer en société.
Apprendre à dire non et se faire respecter
Inculquer le consentement, c’est aussi apprendre à votre ado à faire respecter ses propres limites. Dire non n’est pas toujours facile, surtout à l’adolescence, une période où le désir de s’intégrer et de se fondre dans la masse est très fort.
Mais savoir dire non, c’est poser les bases d’une relation saine, avec soi-même et avec les autres. 🙃
Comme le rappelle un rapport de Santé Publique France :
« Apprendre à dire non et savoir ce que l’on veut, c’est le “premier niveau de consentement” : une négociation intime, de soi à soi. Il s’agit de savoir ce que nous sommes prêts à faire ou à accepter dans notre propre intérêt, voire ce que cela nous apporte. »
👉 Faire respecter son consentement, c’est un apprentissage de tous les instants qui commence tôt et se maintient dans la durée.
Par quoi passe le consentement à l’adolescence ? Exemples concrets
Le consentement dans l’intimité : ce qu’il faut dire à son ado
Dans la vie intime, le consentement doit être vérifié à chaque étape, et il peut être retiré à tout moment. Veillez à rassurer votre ado : verbaliser son consentement ou son non-consentement, inviter l’autre à le faire aussi. Ce sont des bases pour se sentir en sécurité et vivre des relations plus épanouissantes, surtout au moment des premières expérimentations.
La sexualité doit rester un plaisir partagé, et le fait que le consentement soit explicite ne change rien, au contraire. N’hésitez pas à donner à votre ado des phrases simples pour exprimer ou demander le consentement, sans dramatiser la discussion :
- « Tu sais, c’est important de demander à l’autre s’il ou elle est d’accord, et de dire toi aussi si tu n’es pas à l’aise. »
- « On peut toujours changer d’avis, même en cours de route. »
Et surtout : invitez-le ou invitez-la à poser toutes ses questions. Il n’y a pas de question bête sur ce sujet ! 😉
Comment aborder le consentement avec son fils ?
Dans notre société, le consentement est souvent évoqué au féminin, comme si la question ne concernait pas les garçons.
« Quand le consentement apparaît, c’est en tant qu’adjectif et au féminin: “ consentante”, comme s’il ne pouvait se penser au masculin, ce qui n’est pas sans lien avec les représentations sociales de la sexualité attribuées aux femmes et aux hommes.» Bajos N., Bozon M. dir. Enquête sur la sexualité en France
Or, il est essentiel d’en parler aussi avec eux. Pendant la puberté, et même après, ils ressentent beaucoup de pression autour de la performance ou de la virilité… mais on leur parle rarement de respect, d’écoute ou de responsabilité. 🙄
N’hésitez pas à lui dire, très simplement :
« Tu n’as jamais à faire quelque chose parce qu’on te le demande ou parce que tu penses que c’est ce que doit faire un garçon. Et surtout, tu ne dois jamais insister si l’autre ne veut pas. Même si tu trouves que la réponse est floue, même si l’autre ne dit pas “non” clairement. Si ce n’est pas un vrai “oui”, alors c’est non. Ce qui compte, c’est que chacun soit à l’aise, écouté et respecté. »
Pour aborder le sujet, partez d’un cas concret : une scène d’une série, un fait d’actualité ou une situation vécue peuvent servir de point de départ. Privilégiez les questions ouvertes (« Tu penses qu’il aurait dû faire quoi à ce moment-là ? ») et exprimez vos valeurs sans dramatiser :
« Ce qui compte pour moi, c’est que tu te respectes et que tu respectes l’autre, dans toutes tes relations. »
Au-delà de la sexualité, les manifestations du consentement
Le consentement n’est pas réservé à l’intimité. C’est une règle valable dans toutes les situations du quotidien :
- Faire un câlin à un ami ? Demander avant s’il est d’accord.
- Aider une personne à traverser la rue ? Lui demander si elle souhaite de l’aide.
- Donner un conseil ? Demander : « Tu veux un conseil ? »
- Chez le médecin ? Le professionnel doit toujours expliquer et demander l’accord avant un acte.
Bref, c’est savoir que l’autre a des limites et les respecter, même avec la meilleure intention du monde. 🫶
Quelqu’un n’a pas respecté le consentement de mon ado : comment réagir ?
Tout dépend du contexte :
- En cas de contexte sexuel ou traumatisant : il faut absolument ouvrir le dialogue, aider à mettre des mots sur ce qui s’est passé, accompagner votre enfant dans ses démarches (dépôt de plainte si besoin, suivi psychologique).
Retrouvez les conseils détaillés de la fondation Action Enfance : consultez des professionnels et n’hésitez pas à porter plainte en cas de violence ou contrainte. - En cas de gêne ressentie dans le quotidien : encouragez votre ado à verbaliser, à dire ce qu’il a ressenti, et rassurez-le sur le fait que poser ses limites est normal et sain.
Les ressources clés pour aborder le consentement avec son ado
Voici quelques ressources accessibles qui permettent d’aborder le consentement en douceur :
Pour les ados
- Podcasts « Ton corps c’est toi » de Maëlle Challan Belval pour parler de consentement, de sexualité et de rapport au corps à l’adolescence.
- Site de l’INJEP : « L’intimité et la sexualité en ligne à l’adolescence » une ressource fiable avec toutes les informations essentielles, pour les ados et leurs parents.
- Podcast La chose étrange, des épisodes sur le corps, la sexualité, la masturbation et des réponses aux questions des ados.
Pour les parents
- Episode Parentalité et adolescence pour accompagner son ado dans ses premières relations affectives et sexuelles.
- Radio France : Le consentement chez les jeunes enfants et les ados, un indispensable pour commencer !
💡 Pour accompagner la lecture de votre adolescent, privilégiez des ouvrages accessibles et adaptés à son âge, qui abordent des thèmes importants comme l’amitié, la confiance en soi, les relations et le respect. Par exemple, à partir de 13 ans, des romans jeunesse comme Ni Prince, ni Charmant de Florence Medina permettent d’aborder la question du consentement de façon progressive et bienveillante.
Vous avez désormais les clés pour parler de consentement avec votre ado. N’oubliez pas :
« Parler de consentement, ce n’est pas seulement expliquer la différence entre un “oui” et un “non”. C’est transmettre à votre ado une boussole qui lui permettra de se respecter, de respecter les autres et de poser clairement ses limites dans toutes ses relations, qu’elles soient amicales, affectives ou amoureuses. En en parlant tôt, simplement et régulièrement, vous l’aidez à se sentir en sécurité, à développer son esprit critique et à construire des relations saines, libres et équilibrées. » Anne-Claire de Pracomtal, psychologue.
Pour d’autres conseils, rendez-vous directement sur notre blog dédié aux parents d’ados !
Surpoids chez les ados : comprendre, agir, accompagner sans culpabiliser
Y a-t-il de plus en plus d’ados en surpoids ? Malheureusement, oui. Entre 1975 et 2016, le nombre d’adolescents obèses a été multiplié par 4 dans le monde, selon l’OMS. Et la tendance se confirme encore aujourd’hui, notamment chez les garçons. 😶
L’adolescence est une période charnière : votre jeune grandit, il ou elle change, forge son identité. C’est aussi un moment où certaines habitudes (alimentaires, physiques ou psychologiques) s’installent durablement. Et quand le surpoids ou l’obésité s’invitent à cette étape, les conséquences peuvent suivre toute une vie : mal-être, isolement, diabète, troubles cardiaques,...
Ce guide a pour but de vous aider à mieux comprendre les enjeux du surpoids à l’adolescence, à repérer les signaux, et à savoir vers qui se tourner pour agir sans culpabiliser ni stigmatiser. 🫶
Surpoids à l’adolescence : ce que disent les chiffres
C’est quoi exactement le surpoids ?
D’un point de vue médical, surpoids et obésité correspondent à un excès de masse grasse dans le corps, c’est-à-dire une accumulation de graisse qui nuit à la santé. On les mesure à l’aide de l’IMC (indice de masse corporelle), calculé en divisant le poids par la taille au carré. 🤓
IMC = Poids en kg / (Taille en cm)²
Exemple concret :
- Poids : 70 kg
- Taille : 1,75 m
IMC = 70/ 175²
👉 Résultat : IMC = 22,9, ce qui correspond à la zone de poids normal selon l’OMS (18,5 – 24,9).
- IMC entre 25 et 30 → surpoids
- IMC ≥ 30 → obésité
Même si ce calcul est simplifié, il permet d’alerter sur une éventuelle surcharge pondérale, surtout quand il est utilisé en complément d’un suivi médical.
Ce que disent les chiffres sur le surpoids à l’adolescence ?
En France, 4 % des jeunes de 6 à 17 ans sont en situation d’obésité, et 17 % sont en surpoids ou en situation d’obésité selon la Haute Autorité de Santé (HAS). C’est deux fois moins qu’aux États-Unis, mais cela reste un chiffre important.
Pourquoi ? Parce qu’à cet âge, le corps est encore en construction. Le cœur, les poumons, les os, le cerveau : tout est en évolution. 🤯 Et un excès de poids peut déjà entraîner des complications : hypertension, diabète de type 2, troubles musculosquelettiques… sans parler de l’impact psychologique, souvent invisible mais bien réel, sur l’estime de soi et les relations sociales.
👉 Face à ce constat, le gouvernement français prévoit un plan national contre l’obésité pour la rentrée 2025. Objectif : agir à tous les niveaux : prévention, éducation, activité physique, et accès aux soins (y compris médicamenteux). Une stratégie globale, qui pourrait permettre d’accompagner les familles plus efficacement.
Pourquoi nos ados sont-ils particulièrement sujets à l’obésité ?
La sédentarité de nos ados : un fléau silencieux
Nos adolescents bougent de moins en moins, et ce n’est pas qu’une impression. 👀 Les écrans sont omniprésents : jeux vidéo, réseaux sociaux, streaming… Ils adorent. Et qui peut les blâmer ? Ce sont des sources de divertissement, de lien social, parfois même de réconfort. Le problème, c’est que ces activités sont très souvent... passives.
Selon l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail (ANSES), 66 % des 11-17 ans dépassent simultanément les seuils de sédentarité : plus de 2 heures de temps d’écran par jour et moins de 60 minutes d’activité physique. Plus préoccupant encore, un ado sur deux présente un risque sanitaire très élevé, avec plus de 4h30 d’écran par jour et/ou moins de 20 minutes d’activité physique. 😕 Une sédentarité qui s’installe souvent dès le collège, dans un quotidien rythmé par les devoirs, les transports, l’école... et très peu de sport.
Ce n’est pas de leur faute. Le mode de vie des ados d’aujourd’hui est construit autour de la sédentarité.
Les devoirs se font assis, les cours aussi. Les pauses se passent souvent sur un canapé ou un lit, smartphone en main. Et sans accompagnement, il est difficile pour un ado de prendre seul la décision d’aller marcher ou faire du sport. D’où l’importance, en tant que parent, d’encourager le mouvement au quotidien, sans tomber dans l’injonction. 😉
Nos ados mangent-ils mal ?
C’est une question que beaucoup de parents se posent. Et la réponse est souvent... oui, mais pas forcément de leur plein gré !
L’adolescence est une période charnière en matière d’alimentation.
👉 Vers 10 ans, l’enfant commence à gagner en autonomie : premiers achats de snacks, premiers repas pris seul ou entre amis.
👉 Entre 11 et 14 ans, le cadre familial reste majoritaire, mais on sent poindre l’envie de faire ses propres choix.
👉 Et autour de 15 ans, c’est la liberté qui prime : l’ado mange seul, dehors, parfois sur le pouce. Il est alors tiraillé entre ce qu’il a envie de manger (plaisir, rapidité, goût) et ce qu’il “devrait” manger (équilibre, santé, nutrition). Un conflit permanent entre le bon à manger et le bien manger.
Le cerveau des ados joue aussi un rôle : ils sont plus sensibles aux récompenses immédiates. Une canette de soda ou un fast-food leur procure un shoot rapide de plaisir. 🥤 C’est normal. Mais dans un environnement saturé de produits gras, sucrés et salés, leur alimentation peut rapidement basculer vers l’excès, surtout si l’éducation nutritionnelle est insuffisante.
💡 Autre point important : le marketing alimentaire cible spécifiquement les jeunes, via les réseaux sociaux ou des campagnes visuelles très efficaces. Les produits ultra-transformés, colorés, bon marché et pratiques à emporter sont omniprésents dans leur quotidien.
Le lien entre surpoids et santé mentale
C’est un sujet souvent sous-estimé, et pourtant central.
L’adolescence est une période de grands bouleversements psychologiques : recherche d’identité, pression sociale, transformation du corps, premières histoires d’amour, regard des autres… Dans ce contexte, l’alimentation peut devenir une béquille. Manger (ou ne pas manger), c’est aussi une manière de gérer ses émotions.
Le surpoids peut rapidement devenir source de souffrance psychologique : honte, perte de confiance, isolement, moqueries… À une période où le regard des autres pèse lourd, le corps devient un objet de comparaison permanent. Et certains adolescents sombrent alors dans des troubles du comportement alimentaire (TCA) comme la boulimie ou l’hyperphagie, souvent liés à un mal-être profond.
Les chiffres sont parlants : en France, 1 million de personnes souffrent de TCA, en majorité des jeunes de 15 à 24 ans. Et ce chiffre continue d’augmenter.
Selon la HAS, il est essentiel de repérer précocement les signes de mal-être pour proposer un accompagnement adapté. Parmi les signaux à surveiller :
- une instabilité de l’humeur ;
- des troubles du sommeil ou de l’alimentation ;
- un isolement social, une perte d’intérêt pour les activités habituelles ;
- une baisse des résultats scolaires,
- ou encore une image corporelle très négative.
D’autres comportements doivent également alerter, comme un refus systématique de se rendre à la cantine ou de participer à des activités sportives, ou des propos dévalorisants sur soi-même. Ces signes ne doivent jamais être banalisés. Ils méritent d’être entendus, et parfois discutés avec un professionnel. 🫶 Car dans bien des cas, le poids n’est que la partie visible d’un mal-être plus profond.
Mon ado est en surpoids : comment l’aider ?
Pas facile d’aborder la question du surpoids avec un adolescent. Leur corps change, leur regard sur eux-mêmes aussi. Ils sont à fleur de peau, et les mots peuvent autant blesser que soigner. L’objectif n’est pas de “faire maigrir” à tout prix, mais de soutenir un ado dans sa recherche d’équilibre.
Communiquer sur le surpoids de son adolescent
Tout commence par les mots. Et à cet âge-là, ils comptent double. L’adolescence est une période de grande vulnérabilité, en particulier sur le plan de l’image corporelle.
“Leurs comportements alimentaires varient, notamment selon la représentation qu’ils ont d’une norme corporelle idéale. Cette norme est différente selon le sexe. Les filles se voient souvent trop grosses tandis que les garçons sont plus laxistes. Les adolescents cherchent à ressembler à leurs idoles. Les chanteuses de R’n’B, comme Beyoncé, sont plébiscitées dans tous les milieux, pour leurs corps bien en chair, sain et sportif.” Véronique Pardo, anthropologue.
🎯 Ce qu’il faut éviter absolument :
- Les remarques sur le physique, même sous forme d’humour : “Tu devrais ralentir sur les gâteaux”.
- Les comparaisons avec un frère, une cousine ou un parent : “Ton cousin, lui, fait du sport tous les jours.”
- Les injonctions culpabilisantes : “Si tu continues comme ça, tu vas avoir des problèmes.”
💡 Ce qui peut faire la différence :
- Des phrases ouvertes, non jugeantes :
« Est-ce que tu te sens bien dans ton corps en ce moment ? » - Des encouragements à prendre soin de soi, sans pression :
« Je me disais qu’on pourrait trouver une activité qui te fait du bien, ça te dit qu’on cherche ensemble ? » - Des gestes de soutien discret : mettre à disposition des aliments sains à la maison, proposer une promenade en famille, ou préparer ensemble un repas équilibré qui donne envie.
- Impliquer l’ado dans les choix alimentaires :
Faire ensemble la liste des courses, l’inviter à choisir une nouvelle recette saine à tester, cuisiner en duo pour que l’alimentation soit source de plaisir et de partage. - Encourager l’activité physique plaisir plutôt que la performance :
Danser dans le salon, faire du vélo ensemble, marcher avec des amis ou jardiner. L’essentiel est que l’activité soit vécue comme un moment agréable, sans objectif de résultat. - Montrer l’exemple :
Adoptez vous-même une relation saine à la nourriture et à l’activité physique, sans discours culpabilisant ou obsessionnel. Votre ado vous observe et apprend beaucoup par mimétisme. - Renforcer l’estime de soi globale :
Valorisez-le pour ses efforts, ses qualités ou ses talents qui n’ont rien à voir avec l’apparence physique : sa créativité, son humour, sa gentillesse, son engagement… Cela aide à construire une confiance durable, indépendante du regard sur le corps.
Repenser l’hygiène de vie de son ado : quelques idées
🏃♀️ Côté activité physique :
À l’adolescence, la régularité est plus importante que l’intensité. L’enjeu n’est pas de faire courir son ado tous les matins, mais de l’aider à intégrer une activité physique qu’il ou elle aime vraiment. On peut :
- lui proposer de tester plusieurs sports avec un ou une amie ;
- l’encourager à rejoindre un club ou une équipe pour y trouver un vrai collectif (ce qui compte beaucoup à cet âge) ;
- l’aider à comprendre que le sport, c’est aussi une manière de mieux dormir, se défouler, se sentir fort·e, s’aérer la tête.
🍎 Côté alimentation :
L’important, c’est d’éviter la logique du “régime” et de favoriser une alimentation variée, sans dramatiser. On peut :
- Cuisiner ensemble des plats équilibrés mais gourmands ;
- L’aider à reconnaître les signaux de faim et de satiété ;
- Parler de nutrition comme d’un levier pour l’énergie, le sommeil, l’humeur, pas juste le poids.
⚠️ À éviter absolument (ce qui génère de la frustration) :
- les pesées régulières imposées ;
- les interdits catégoriques ;
- la survalorisation de la minceur.
L’objectif ? Que l’ado se sente acteur ou actrice de son propre bien-être, et non sous surveillance.
💡Et attention aux réseaux sociaux : certains contenus peuvent être problématiques. Par exemple, sur TikTok, on retrouve le "skinny tok" (qui glorifie la maigreur et les comportements restrictifs, aujourd’hui interdit en France) ou encore les vidéos de “mukbang” (qui banalisent l’hyperalimentation). Le rapport de l’adolescent à son corps est souvent influencé par ces formats, et il est précieux d’en discuter ouvertement avec lui.
Les professionnels qui peuvent vous aider
Si vous sentez que la situation dépasse ce que vous pouvez gérer seul(e), il est essentiel de s’entourer. Et surtout, de ne pas attendre trop longtemps.
🤝 Voici les professionnels qui peuvent accompagner votre ado (et vous !) :
- Le médecin généraliste : pour évaluer la situation de santé, poser un cadre.
- L’endocrinologue : si un trouble hormonal est suspecté.
- Le nutritionniste ou diététicien : pour établir une relation saine à l’alimentation, loin des régimes restrictifs.
- Le psychologue ou pédopsychiatre : pour travailler l’estime de soi, les troubles de l’image corporelle, ou repérer des troubles du comportement alimentaire (hyperphagie, boulimie…).
Chez IAMSTRONG, nos coachs certifiés et psychologues aident les ados à prendre confiance en eux grâce à une approche positive, inspirée des Thérapies Cognitivo-Comportementales (TCC) et du coaching.
Notre accompagnement repose sur trois piliers : des séances individuelles en visio avec un professionnel choisi selon vos problématiques, des activités à faire en ligne pour approfondir le travail entre les séances, ainsi qu’un chat pour un soutien en continu.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à prendre rendez-vous gratuitement pour faire le point.
Surpoids à l’adolescence : les ressources inspirantes
Changer de regard, se sentir moins seul, mieux comprendre son ado… Voici quelques ressources utiles à découvrir en famille ou en solo.
- Le podcast Vivons heureux avant la fin du monde : Épisodes sur l’alimentation, le corps, la pression sociale (Mince, une injonction !)
- Le roman Le corps n’oublie rien (Bessel van der Kolk) : Pour mieux comprendre le lien entre corps, émotions et histoire personnelle.
- Le guide nutrition des ados (Ministère de la Santé) : Pour mieux comprendre les besoins nutritionnels des ados
Aider son ado à traverser une période de surpoids, ce n’est pas “corriger” un corps, c’est l’accompagner dans l’écoute de ses besoins, la construction de son estime de soi, et l’apprentissage de l’autonomie. 🥰 Et ça, c’est un chemin qui se fait ensemble, avec un entourage éveillé et soutenant.
Vous avez d’autres questions ? Rendez-vous sur notre blog dédié aux parents d’ados !
Comment l’IA change le quotidien des adolescents
L’intelligence artificielle. On en parle partout : en entreprise, à la maison, à l’école… Les ados comme les adultes apprennent à utiliser cet outil qui change complètement la façon de se renseigner, d’apprendre, de travailler. 🤖
Concrètement, qu’est-ce que cela change pour nos ados ? L’IA est-elle un risque ou une opportunité ? On vous aide à comprendre comment nos jeunes utilisent l’IA et quelles sont les bonnes pratiques pour les préserver des risques associés.
Quel rapport nos ados entretiennent-ils avec l’IA ?
Avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite définition rapide de l’IA, proposée par le bureau des éclairages mondiaux et des politiques de l’UNICEF : « La technologie de l’IA fait référence aux ordinateurs ou aux dispositifs programmés pour effectuer des tâches que nous pensons normalement réservées aux êtres humains. Ils reproduisent, pour ce faire, notre manière de penser ou notre comportement. »
À votre avis, comment l’IA est-elle perçue par nos ados ? Sont-ils curieux ? Novices ? Vigilants ? Sont-ils en avance sur le sujet ? 🤔
Ils sembleraient qu’ils aient cédé à la tendance. Ils sont près de 80% à avoir déjà intégré l’IA dans leurs habitudes. Cette habitude commence à se dessiner à la fin du collège et se confirme au lycée.
Les adolescents font souvent un usage très « basique » de l’IA. Par exemple, ils sollicitent ChatGPT pour des besoins ponctuels, comme rédiger un devoir ou trouver une information rapidement, sans forcément questionner la qualité de la réponse ou réfléchir aux conséquences de leur geste. Ce qui leur plaît, c’est la promesse d’instantanéité.
Ils ne s’inquiètent pas de savoir comment l’IA transforme leur quotidien, ni de l’impact très concret de ces outils sur leurs facultés cognitives ou leur santé mentale. Chez IAMSTRONG, on a mené l’enquête !
Comment l’IA impacte la vie de nos adolescents ? Les principaux usages
Comprendre les usages de l’IA par nos ados
L’IA est désormais pleinement intégrée au quotidien de nos jeunes. Il semblerait même qu’ils aient délaissé Google et autres moteurs de recherche au profit de l’IA. Pourquoi ? Selon une étude du Blog du Modérateur, 44% des adolescents trouvent que les réponses sont plus rapides, et 42% qu’elles sont plus claires. 😯 Parmi les solutions préférées des jeunes, on retrouve Chat GPT, très loin devant My AI (intégré aux réseaux sociaux comme Snapchat) et Gemini (l’IA de Google).
Pour mieux comprendre les usages exacts de l’IA, des chercheurs du Common Sense Media (Etats-Unis) ont mené l’étude The Dawn of the AI Era : Teens, Parents and the adoption of Generative AI at Home and School entre mars 2024 et mai 2024. Résultat ? 4 usages se détachent :
- L’aide aux devoirs (53%)
- Échanger pour ne pas s’ennuyer (42%)
- Traduire du texte (41%)
- Brainstormer, trouver de nouvelles idées (38%)
👉 Nos jeunes se reposent donc sur l’IA pour des projets intellectuels, mais aussi pour des échanges interpersonnels. Explorons ces 2 usages.
Travailler avec l’IA : qu’est-ce qu’on en pense ?
En 2024, selon une étude du Pew Research Center, 26 % des adolescents âgés de 13 à 17 ans déclarent faire régulièrement leurs devoirs avec l’aide d’une IA comme ChatGPT. C’est deux fois plus qu’en 2023.
Mais alors, comment s’en servent-ils exactement ? Les retours sont clairs : les ados utilisent principalement l’IA pour :
- trouver des idées de sujets pour un exposé ;
- faire un brainstorming sur une rédaction ;
- formuler un plan ou structurer un devoir ;
- stimuler leur créativité, par exemple en demandant « comment rendre ce texte plus drôle ? » ;
- corriger des fautes ou reformuler un texte pour qu’il soit plus fluide.
En revanche, ils sont plus mitigés lorsqu’il s’agit de résoudre un problème mathématique ou de rédiger un devoir en entier : beaucoup sentent instinctivement qu’il y a une frontière à ne pas franchir. 👀
Pour les enseignants comme pour les parents, l’encadrement de ces usages est très difficile : comment savoir si un texte a été écrit par l’ado ou par une IA ? À partir de quand parle-t-on d’aide... ou de triche ?
Il est donc important de nuancer le débat. Oui, un usage abusif de l’IA peut nuire à l’apprentissage. Mais utilisée intelligemment, l’IA peut devenir un appui précieux pour accompagner votre ado dans ses devoirs ou la préparation des examens :
- Expliquer un concept difficile : si votre ado ne comprend pas la règle de trois en maths ou la notion d’ironie en français, il peut demander à l’IA d’expliquer avec des mots simples et des exemples adaptés à son niveau et à son âge.
- Structurer une réponse : pour un devoir de philosophie ou une dissertation de français, l’IA peut montrer un exemple de comment organiser une introduction, des arguments et une conclusion, ce qui aide à clarifier la méthode.
- S’entraîner avec des exercices : en vue d’un contrôle, du brevet ou du bac, l’IA peut générer des exercices types ou même des sujets de contrôle corrigés. Par exemple, votre ado peut demander : « Peux-tu me proposer un sujet de contrôle de maths sur les probabilités avec la correction ? » ou « Prépare-moi une série de questions type brevet sur la Seconde Guerre mondiale ».
- S’entraîner à l’oral : pour préparer l’oral du brevet ou du bac, l’IA peut simuler un entretien, proposer des questions possibles et aider à formuler des réponses claires et structurées.
- Relire et améliorer un texte : plutôt que de rédiger à la place de votre ado, l’IA peut l’aider à corriger ses fautes, à enrichir son vocabulaire ou à reformuler des phrases. Cela l’incite à relire et à comprendre ses erreurs, et donc à progresser par lui-même.
- Décomposer une tâche complexe : Beaucoup d’ados se perdent devant un gros projet (exposé, TPE, révision avant examen). L’IA peut aider à découper en étapes claires : recherche → plan → rédaction → présentation. Cela développe l’autonomie et l’organisation. Exemple : « Comment puis-je m’organiser pour préparer un exposé de 10 minutes en histoire ? »
L’enjeu aujourd’hui, c’est donc d’intégrer l’IA dans les pratiques éducatives, et non de la bannir. Comme l’explique Laurence Devillers, professeure en IA à la Sorbonne et directrice de la chaire HUMAAINE au CNRS :
« S’en tenir à une position hostile envers ces systèmes n’est pas viable. Il est essentiel de les comprendre et de les utiliser de manière appropriée. »
💡 D’ailleurs, selon la même étude du Pew Research Center, seulement 9 % des ados pensent qu’il est inacceptable d’utiliser l’IA à l’école. Pour les autres, c’est un outil parmi d’autres.
Au-delà des devoirs, les ados utilisent aussi l’IA… pour discuter
19 % des jeunes ont déjà interagi avec des IA conversationnelles comme Character.AI ou My AI sur Snapchat. Ces outils permettent de parler à un chatbot qui peut incarner un personnage réel ou fictif (une célébrité, un coach, un ami imaginaire…). 🙃
Et pourquoi ces échanges les attirent-ils ? Ceux qui l’utilisent disent que c’est agréable d’avoir une vraie conversation, avec quelqu’un qui écoute, qui répond vite, qui ne juge pas (étude du Common Sense). Certains y trouvent un soutien émotionnel, une forme de compagnie, voire de réconfort quand ils ne veulent pas se confier à leurs parents ou à leurs amis.
Mais attention : si l’IA peut rassurer temporairement, rien ne remplace un vrai regard, une vraie écoute. Aider un ado à mettre des mots sur ce qu’il vit, c’est lui donner des outils pour construire sa confiance intérieure.
Encadrer l’usage de l’IA : les sujets à aborder
Préserver son esprit critique
Premier danger quand on utilise l’IA : ne plus réfléchir par soi-même. Quand tout est à portée de prompt, pourquoi s’embêter à chercher, lire, comprendre, formuler une idée ? C’est particulièrement préoccupant à l’adolescence, une période où le cerveau est encore en construction, notamment sur les fonctions cognitives comme la logique, l’analyse et la prise de recul. 🧠
Autre dérive : l’ado finit par prendre pour argent comptant tout ce que dit ChatGPT. Il ne questionne plus les sources, ne vérifie pas la fiabilité des réponses, et surtout, ne cherche pas à comprendre comment fonctionne l’outil.
Un exemple frappant : d’après une enquête Milan x CSA, plus de deux tiers des adolescents ont déjà vu un deepfake (une image ou une vidéo truquée créée par IA), et savent les reconnaître… Mais seulement la moitié vérifie les informations ou les sources avant de les partager. 😐
Ce réflexe critique est pourtant essentiel. L’IA peut se tromper, être biaisée, ou répondre de manière flatteuse sans jamais opposer de résistance. Comme le rappelle le site Geek Junior :
« ChatGPT est complaisant, pas critique. Il répond, il ne corrige pas. »
👉 Quelques phrases simples que les parents peuvent utiliser pour cultiver l’esprit critique de leur ado face à l’IA :
- "D’où elle sort cette info, tu crois ?"
- "Tu peux vérifier si c’est pareil ailleurs ?"
- "Tu lui as demandé comment elle a trouvé cette réponse ?"
- "Et si tu lui posais la question autrement ?"
Développer une autonomie numérique saine
Le second risque majeur, c’est celui d’une forme de passivité. Si ChatGPT fait tout : rédige, résume, reformule, décide… alors pourquoi faire l’effort soi-même ? 🤔
L’IA est un outil formidable, mais elle ne doit pas devenir une béquille permanente. Le bon usage, c’est de s’en servir comme un appui, pas comme un substitut à l’effort personnel.
👉 Voici quelques conseils concrets à partager avec son ado :
- Utilise d’abord tes propres ressources (cours, manuels, notes).
- Formule ta question à l’IA comme si tu t’adressais à un coach.
- Ne te contente jamais de la première réponse.
- Demande à l’IA de t’expliquer le raisonnement, pas juste la réponse.
- Alterne : parfois avec l’IA, parfois sans, pour garder la main.
C’est aussi l’occasion d’aborder l’éducation au numérique : savoir chercher une information, croiser les sources, se poser des questions, douter… Ce sont des compétences clés aujourd’hui.
La protection des données personnelles
Un point souvent oublié par les ados (et beaucoup d’adultes) : tout ce qu’on tape dans une IA est stocké et analysé. Et une fois les données envoyées, il est quasi impossible de les effacer. 🥲
Photos, vidéos, adresses, données personnelles… Même une simple demande d’aide aux devoirs peut transmettre des informations sensibles.
Selon l’étude Milan x CSA, 71 % des ados sont conscients des risques liés à la protection de leurs données personnelles avec l’IA. C’est bien, mais ce n’est pas suffisant.
👉 Quelques bons réflexes à adopter et à transmettre :
- Ne jamais partager de données personnelles ou de photos avec une IA
- Effacer l’historique de ses conversations dans les paramètres.
- Utiliser l’IA en mode navigation privée ou déconnecté si possible.
- Vérifier les réglages de confidentialité sur les applis (Snapchat, MyAI…)
💡Et ce n’est pas anodin : en 2023, le régulateur italien (la Garante) a accusé OpenAI, créateur de ChatGPT, de ne pas respecter les règles sur la protection des données, et de ne pas filtrer correctement l’accès aux mineurs.
Les enjeux écologiques liés à l’IA
L’IA semble magique : rapide, fluide, accessible 24h/24… Mais ce confort a un coût écologique massif, souvent invisible pour les jeunes.
Chaque interaction avec une IA repose sur des serveurs énergivores, refroidis en continu. Par exemple, la phase d’entraînement de GPT-3 a généré 626 000 kg de CO₂, soit :
- 72 fois le tour de la Terre en voiture
- ou la fabrication de 3 244 ordinateurs portables.
Autre chiffre frappant : si 10 % des travailleurs américains utilisaient ChatGPT une fois par semaine pendant un an pour rédiger un e-mail, cela consommerait 435 millions de litres d’eau.
👉 Pourquoi et comment en parler avec son ado ?
- Pour développer leur conscience écologique : "Tu savais que chaque question que tu poses a un coût carbone ?"
- Pour les inviter à doser leurs usages : "Pose-toi la question : est-ce vraiment utile de passer par ChatGPT pour ça ?"
- Pour encourager une utilisation sobre et intelligente : regrouper ses questions, privilégier des recherches classiques si c’est plus efficace, etc.
5 questions à poser à votre ado quand il utilise ChatGPT
Pas besoin d’être expert pour accompagner son ado dans l’usage de l’IA. Le plus efficace, c’est souvent de poser les bonnes questions, au bon moment, pour l’aider à prendre du recul. Voici 5 questions toutes simples à glisser dans une discussion :
- Pourquoi tu as utilisé ChatGPT ?
Pour comprendre s’il s’agit d’un réflexe ou d’un vrai besoin. - Tu lui as demandé comment il a trouvé sa réponse ?
Pour l’amener à questionner la source et la méthode. - Tu penses que c’est fiable ? Tu peux le vérifier ?
Pour réveiller son esprit critique et éviter l’effet “vérité automatique”. - Tu avais une idée avant de lui poser la question ?
Pour qu’il garde confiance en ses propres capacités de raisonnement. - Tu as appris quelque chose en l’utilisant ?
Pour différencier un usage utile d’un usage passif.
L’objectif, ce n’est pas de surveiller, c’est de dialoguer et d’aider l’adolescent à devenir un utilisateur conscient et éclairé. 🫶
Les ressources pour intégrer sainement l’IA à son quotidien
Il existe encore peu de guides spécifiquement conçus pour les parents et leurs ados, mais certaines ressources peuvent déjà faire la différence.
📚 Notre sélection :
- Le guide de l’UNICEF pour les ados (FR)
Un document clair et accessible pour mieux comprendre l’IA. - Guide “C’est pas moi, c’est l’IA !” – Geek Junior
Parfait pour aborder l’IA avec humour et pédagogie. - YouTube “Info ou Mytho” – Milan Presse
Des vidéos bien faites pour apprendre à repérer les fake news et deepfakes. - Fiche ProfExpress – L’éducation à l’IA
Utile pour les enseignants… et les parents curieux !
L’IA transforme profondément le quotidien des adolescents. Pour les accompagner sereinement, l’essentiel est de dialoguer, éveiller leur esprit critique et leur apprendre à utiliser ces outils avec discernement.
Chez IAMSTRONG, on croit qu’un adolescent bien accompagné est un adolescent capable de tirer le meilleur du numérique. Notre mission ? Donner aux parents les clés pour guider leurs enfants avec confiance, dans un monde qui change vite. Pour en savoir plus sur nos programmes de coaching, n’hésitez pas à convenir d’un premier bilan gratuitement.
Vous avez besoin d’autres conseils pour encadrer l’usage des écrans ou aider votre ado à préparer ses examens ? Rendez-vous sur notre blog dédié aux parents d’ados !